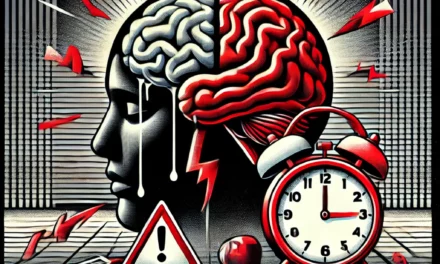Dans Une psy parle aux esprits, Martine Gercault nous invite à la suivre dans sa quête d’une approche clinique autre qui prend en charge la demande des patients pour les aider à aller vers un mieux-être et se révéler à eux-mêmes. En nous narrant ses propres reconstructions après deux agressions très violentes et son passage à des approches moins conventionnelles pour réapprendre à aimer la vie, Martine Gercault fait apparaître des possibilités nouvelles d’exploration existentielle et spirituelle. Extraits.
Psychanalyse et chamanisme sont-ils d’irréconciliables ennemis ? La psychologue clinicienne Martine Gercault prouve, par sa pratique et sa réflexion, qu’il n’en est rien. Extrait d’Une psy parle aux esprits*.
Prélude au voyage initiatique
Ce livre est l’histoire d’une quête au-delà de l’espace et du temps, si ancienne que le souvenir se perd dans le labyrinthe de ma mémoire oubliée. Il est aussi forme en mouvement, invitation l’éveil et au voyage. Souvent survient en moi l’intime certitude d’être une vieille âme issue des mystères, troublée par les vocables de la « Reine de la Nuit », car née d’elle. Certains s’étonneront de voir mêlés dans cet ouvrage des pans de ma vie personnelle et mon évolution clinique. J’ai longuement réfléchi à ce mode peu « orthodoxe » qui pourrait être qualifié par certains d’« hérétique ».
Ayant choisi d’être libre, hors des conventions et chemins tracés d’avance, j’ai toujours regardé la vie comme une suite incessante de sens, une sorte de jeu de piste. Ainsi ai-je conduit la mienne.
J’ai croisé sur ma route plusieurs figures novatrices qui me permirent de me délier et de m’ouvrir à l’Âme du Monde. Trois prédominent par l’originalité de leur enseignement d’avant-garde et les remises en question de l’ordre établi qu’elles menèrent avec une détermination dotée d’une grande intégrité scientifique et thérapeutique.
Michel Sapir, Stanislav Grof et Sandra Ingerman nourrirent ma réflexion et mon travail clinique de façon essentielle.
Je leur rends hommage et les remercie pour tout le chemin parcouru.
Quand une psy brise le tabou des thérapies alternatives
« La vie est un courant sans fin et chaque homme s’ancre dans le courant auquel il appartient. Il ne peut être détaché ni de ses ascendants, ni de ceux qui l’ont fait naître, ni de ceux qui assureront sa descendance. Être ancré dans une telle lignée d’appartenance, ce n’est pas comme être inscrit d’une façon symbolique dans un arbre généalogique. C’est sentir dans son corps la présence de ses parents, de ses grands-parents et sentir que son propre corps vit dans celui de ses enfants. »
Femme de voyage, j’ai favorisé le mouvement, l’ouverture et le changement, le départ vers des terres inconnues. Quand plusieurs routes s’offraient à moi, je suivais celles encore inexplorées, osant l’initiation du vivant.
Amatrice et défricheuse d’énigmes, le mystère m’a toujours irrésistiblement attirée. Mon cabinet est un lieu sacré d’accueil et de reconstruction. Je m’y sens heureuse, et mes patients en aiment l’atmosphère sereine, propice au recueillement. Il reflète mon goût pour l’odyssée, le lointain et les détours. Inspirée par Sri Nisargadatta Maharaj, j’invite le consultant à se déposer dans le lâcher-prise : « Vous ne devez creuser qu’à un seul endroit, au-dedans. Voyez ce que vous êtes. Ne le demandez pas aux autres, ne les laissez pas vous parler de vous. Regardez au-dedans, et voyez… » Devenez qui vous êtes.
J’ai constamment vécu des morts suivies de renaissance. Mon ascendant fin scorpion m’y prédispose. J’eus aimé naître quelques minutes plus tard et ne pas être stigmatisée par ce signe bivalent de décomposition et de transformation qui me fit connaître des moments de challenges, de grand bonheur, mais aussi parfois de tourmente. Tel le phénix, je me consumais pour inlassablement renaître de mes cendres et repartir à la conquête de la vie en une formidable danse.
A quarante ans, la mienne vola en éclat. J’allais rencontrer ce dont depuis toujours j’avais l’intuition, l’existence d’autres mondes dont la visibilité nous fait défaut en état de conscience ordinaire. La respiration holotropique en fut la première porte. Il me restait à franchir les suivantes. Plus je gravissais les échelons, plus les degrés me paraissaient hauts et insurmontables. Il me fallut accueillir le lâcher-prise et l’incertitude, m’abandonner à la joie d’explorer, d’être dans le non-savoir. Mon destin fut d’accepter les remises en cause successives, les séjours dans le « désert » durant lesquels je me rassemblais sans fioritures ni artifices.
Solitude imposée pour sans cesse me renouveler, et décliner la vie dans ses couleurs multiples.
Une amie, un matin, m’adressa ce texte de Mikhaël Aïvanhov : « La vie spirituelle est semblable à une terre dans laquelle vous devez vous enfouir pour croître. Jusque-là, vous ressemblerez au grain qui est resté dans le grenier. Dans ce grenier, évidemment, il est tranquille, il ne subit ni la pluie, ni le vent, ni la grêle, mais bientôt il moisira ou sera grignoté par les souris, ce qui est bien pire. Tandis que le grain mis en terre doit subir les intempéries, mais il pousse, il donne des fruits, il est utile. En embrassant la vie spirituelle, vous ne serez pas à l’abri : vous aurez à affronter le vent et les orages, mais vous trouverez aussi des conditions qui vous permettront de croître et de donner des fruits à l’humanité. N’est-il pas préférable d’être exposé aux intempéries et de croître, plutôt que d’être mangé par les souris et la moisissure ? Avec la vie spirituelle, c’est vrai, vous aurez à subir des épreuves qu’une existence purement matérialiste vous aurait épargnées, mais que cela ne vous trouble pas : continuez à avancer sur cette voie qui vous conduit vers le monde divin.»
« Tout voyage, toute aventure se double d’une exploration intérieure. Il en est de ce que nous faisons, et de ce que nous pensons comme de la courbe extérieure et de la courbe intérieure d’un vase : l’un modèle l’autre ». Un appel se fait entendre, notre âme cogne.
En déployant nos ailes, nous répondons à notre vision, celle qui mène vers nous -mêmes. Nous n’en sortons pas toujours indemnes, mais devenons le héros de notre vie. La voie est ouverte.
Tout le reste est secondaire.
« On ne devrait lire, écrivait Kafka, que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing sur le crâne à quoi bon lire ? Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. »
Puisse-t-il en être ainsi, sans fard…
Je me souviens, aux origines
… Dès l’aube, je choisis de placer ma vie sous le signe de l’ouverture. Déblayer les embûches, déraciner la souffrance pour vivre la joie intérieure de m’éveiller à celle que j’étais.
Très tôt, je ressentis le poids des oripeaux sous lesquels j’étais ensevelie. Intuitivement, je savais ne pas être née.
Je n’étais pas celle que les autres voyaient. J’observais le monde autour de moi sans y prendre vraiment part. Il m’était étranger. Mon enfance et mon adolescence furent des temps entre parenthèses, des temps de germination.
Quand je me penche sur ma vie, elle me semble multiforme, non conventionnelle, aventureuse et riche, souvent mystérieuse. J’ai bravé beaucoup d’interdits familiaux en devenant ce que je suis, c’est-à-dire hors norme.
D’un milieu très traditionnel, imprégné par un judaïsme qui ne me satisfaisait pas toujours, j’ai étudié d’autres sources pour trouver des réponses à des questions qui jaillirent très tôt en moi. Il me fallait donner un sens à ma vie, explorer et découvrir, souvent seule. C’est ainsi que j’ai côtoyé le soufisme, le bouddhisme et l’hindouisme. Aujourd’hui, ma spiritualité est transpersonnelle ; ma quête, une recherche du sacré, au-delà de l’ego, hors toute religion.
Née cinq ans après la fin du cataclysme de la Seconde Guerre mondiale, j’ai longtemps été hantée par les fumées de l’Holocauste, scandant ma jeunesse d’incessants « Pourquoi ? ». Je demeurais suspendue dans des temps sans réponses, le présent se conjuguant toujours au passé, dans l’absence. Les voix brisées de mes ancêtres m’ont traversée de leurs cris, imbibant ma mémoire d’une ombre fantomatique, indélébile, exigeante. Leur existence bouleversée, fissurée et violée, a sans aucun doute suscité très tôt chez moi le désir d’accompagner l’autre à retrouver son humanité, sa dignité, pour l’aider à se resituer dans le vivant.
Très aimants, mes parents semblaient voir en moi une extraterrestre aux illusions fantasques, douce, rêveuse… et certainement très déconcertante. Une mutante ? Marquée du sceau des persécutions raciales vécues par les miens, je passai ces années auprès d’un père qui était un « guerrier », franc-maçon très engagé dans la lutte pour les droits de l’Homme, et d’une mère tendre, mais quelquefois distante, énigmatique, souvent insaisissable. L’expression Zakhor ! N’oublie pas ! scanda ma jeunesse comme un leitmotiv.
Mon père, hanté toute sa vie par ce Zakhor, coulera ses dernières années dans l’évanescence puis l’altération profonde de sa propre mémoire, mais non pas celle de la Shoah, toujours présente. Il partit non endormi sur son passé, habité par le souvenir intact de l’innommable, fidèle jusqu’au silence final, à ce verset de l’Exode « Tu le raconteras à tes enfants7. »
Il me fallut être une gardienne de la mémoire. La Shoah, ce drame collectif très douloureux, orienta certainement mon désir d’être psychothérapeute et servir une cause humanitaire. J’ai toujours, depuis mon plus jeune âge, été solidaire de ceux qui luttent contre la maltraitance et l’injustice.
Revendiquer ma place, faire brèche dans ce cercle transgénérationnel infernal stigmatisé par les persécutions, fut un long travail d’accouchement puis de guérison. La psyché familiale, entachée du traumatisme, se décalqua assurément sur la mienne dans une sorte de fidélité et d’allégeance. Je dus me soustraire à cette violence par un parcours psychanalytique, spirituel et chamanique. Incontournable.
La psychanalyste à qui j’ai donné naissance ne pouvait, à son tour, qu’aider d’autres humains en errance douloureuse à voir le jour et retrouver la puissance du souffle en une odyssée au cœur d’eux-mêmes.
Ma génération eut pour mission d’être la garante d’une mémoire à jamais vivante. Et ce « N’oublie pas » diffusa en moi comme un mantra. Je ressentais une culpabilité à vivre libre ma jeunesse, alors que ma mère, si souvent, nous disait sa honte et sa souffrance, à quinze ans, d’avoir porté l’étoile jaune qu’elle devait camoufler derrière ses livres scolaires. Elle parlait peu de ses sentiments, inhibée par ces années de guerre qui furent une période ratée, confuse, erratique, jalonnée par des peurs intestines :
« Nous devions survivre, pourchassés et traqués comme des bêtes. Jusqu’en 1939, mon adolescence fut studieuse et se déroula dans une bulle, en vase clos, protégée. Nous aspirions à la tranquillité. Mes parents, arrivés de Pologne en 1920, avaient fui les pogroms. Mon père aimait pourtant son pays natal et eut souhaité, lors de la Première Guerre mondiale, s’enrôler dans l’armée polonaise. Sa demande fut rejetée, car il était juif. Durs au labeur, ils ne cessèrent pas de travailler pour s’implanter, s’assimiler et mériter cette terre de la liberté qui les avait accueillis. »
Souvent, petite fille, j’entendais mon grand-père maternel Abraham, pieux et mystique, dire en yiddish « Men ist azoy wie Gott in Frankreich * ». Comme de nombreux Juifs ashké-nazes d’Europe centrale, il avait rêvé à la France républicaine et laïque, pays des droits de l’Homme et de la culture. Cette sorte de Terre promise idéalisée fut le premier pays qui accorda leur émancipation aux Juifs, le 13 novembre 1791. Malgré Vichy et la Shoah, il demeura indéfectiblement fidèle au pays d’asile qui l’avait accueilli. J’aimais l’entendre parler. Sa maîtrise du français laissait encore cependant poindre un léger accent, cet accent si particulier de la langue yiddish assassinée, langue d’un monde perdu, langue maintenant presque disparue du monde des vivants au quotidien.
Ma quête spirituelle s’origine de sa présence, mais aussi de son manque. Longtemps durant, j’ai subi son absence comme une blessure indélébile, malgré des parents attentifs et affectueux, fortement stigmatisés par la Shoah.
Je ferme les yeux, et ressens sous ma main le grain de sa peau et les fils argentés que j’aimais lisser. J’explorais ses poches, m’emparais du petit peigne en corne et le rendais vagabond errant sur son crâne patinoire. Il se laissait faire, installé dans son fauteuil, sous l’horloge qui inlassablement martelait les heures. Combien je détestais ces coups, sinistres ruptures. Il ne semblait plus les entendre et s’en accommodait. Il avait coutume d’allumer un cigare Voltigeurs dont nous conservions la bague. Il le prenait de ses doigts courts. Sa main était trapue et ronde. Il inhalait et exhalait doucement des volutes aériennes pour nous amuser et nous surprendre. J’aimais observer les mouvements de ses lèvres sculptant les spirales éphémères. Suspendue à sa bouche, je les guettais pour m’en saisir. Il répétait immuablement cette gestuelle labiale, sentant mon désir de le découvrir magicien des formes. Je partageais avec lui le silence, l’écoutant comme une mélodie. Souriait-il ? Timidement.
Je le revois, me regardant, me parlant. J’attendais son appel du soir et me précipitais pour décrocher le téléphone. Combien j’aimais entendre sa voix, son allô, allô qui mon tait crescendo. Il était là. Las aussi, fatigué, mais attentif, accueillant les questions que je me pressais de lui poser. Il savait m’accompagner.
Je ressentis un abandon quand il partit. Encore maintenant, il me manque et m’apparaît comme un « phare ». Si souvent, j’eus désiré lui parler, déambulant à sa recherche. Ma quête débuta sur cette carence.
Je vouais à mon père une grande admiration. Tandis que les mots courent et s’envolent, je comprends que ce livre n’aurait pu voir le jour si je n’y avais inscrit la relation toute particulière que j’eus avec lui. Son visage au sourire bienveillant, parfois timide, cachait une immense sensibilité et une solide détermination. Souvent, il m’apparut comme un enchanteur. Rien ne lui résistait ; il attirait et faisait peur. On le craignait et le respectait. On l’aimait. Cet homme courageux et noble, à l’intelligence vive, s’en alla au terme d’une maladie éprouvante, extrêmement douloureuse et invalidante. Son cerveau, grignoté par une affection dégénérative imputée à un diabète dont il se gaussait, le laissait dans une errance psychique délétère, avec cependant, par moments, une conscience non altérée. Ses derniers mois, durant lesquels se surajouta un mal perforant plantaire gangréneux, furent une agonie de chaque instant. Les jours et les nuits se succédaient et se confondaient en des souffrances permanentes inutiles. Je priais pour sa délivrance tout en appréhendant son départ. Je sentais si intensément son calvaire qu’il m’était devenu insupportable de le voir tourmenté en vain.
Quand il rendit l’âme, je saluai sa libération. Mon anesthésie émotionnelle me surprit. J’avais si souvent versé des larmes que mes yeux étaient secs. Son martyre avait pris fin, alléluia ! Il allait pouvoir retrouver la paix, délié de ses chaînes, ô combien multiples. Celles de sa maladie, celles de ses origines, et surtout celles du génocide qui l’habita de façon quasi permanente. Il exprimait la culpabilité du survivant, pleurait les disparus et vécut ses dernières années enfermé dans le culte du souvenir, seul élément vibrant de sa mémoire déliquescente.
Il me revient ce texte que j’écrivis quand il partit :
« Tu vas être porté en terre. Aujourd’hui. Et je vais te lire ces mots pour qu’ils t’accompagnent. Ma main trembla à les écrire, tu venais de t’éteindre. Ton voyage ici s’achève, et tu t’achemines vers les mondes de Lumière. Tu reposes dans la chambre d’à côté, je ne parviens pas à te quitter des yeux. À te quitter, tout simplement. Tu t’es endormi dans mes bras, enfin presque, et j’ai accompli cette “mission” que, toute ma vie, j’ai sentie mienne.
Tant de fois, j’ai rêvé de ta mort. Toujours, elle me hanta. J’avais peur de ton départ. Je me réveillais, la nuit, en sueur, dans l’angoisse de ne pas arriver à temps vers toi. J’étais ton Antigone, celle qui devait t’accompagner. Ce moment fatal, tant redouté, est advenu. Je t’ai reçu dans ton dernier souffle. Ultime au revoir. Va dans la lumière et la paix, accueilli par ceux que, dans ta détresse, épuisé, tu appelais inlassablement. Tu as été un père formidable, un être vrai et intègre, un homme phare pour beaucoup. Je t’admirais et te vénérais tant. Ma vie t’a certainement semblé excentrique à maints égards. Pardonne-moi de t’avoir créé parfois des tourments, je ne pouvais pas toujours acquiescer. Il me fallait rencontrer ma propre vérité. Notre amour allait au-delà des mots et des formes. Nos âmes se connaissaient si bien, familières et fraternelles. J’emploie le passé, j’ai tort. Notre cœur à cœur se prolonge sur un autre plan, dans d’autres dimensions. Tu es vivant en moi, à tout jamais. Ton âme va retrouver son univers intime. Tu reviens… là où tu appartiens.
Poursuis ton chemin dans la sérénité, monte avec confiance sans te retourner. Suis la lumière, laisse-toi envelopper par elle. Je resterai fidèle aux valeurs que tu m’as enseignées et te porterai dans mes méditations. Cette voie spirituelle qui est mienne demeure notre trait d’union. Tu es désormais “dans le monde céleste, celui de l’amour et de l’éveil.”
Que ce poème de Rûmî t’escorte et soit ta monture : “Au moment de la mort, quand l’âme quitte le corps, Elle le laisse comme un habit ancien
Elle redonne à la poussière ce corps qui était poussière Et façonne un corps fait de sa propre lumière ancienne9.”
Tu fus un honnête homme. Tu fus un mensch . »
Deux mois après le décès de mon père, la blessure de sa perte se rouvrit telle une déchirure béante, crue, charnelle, animale. J’étais une louve qui hurlait en silence à la mort. Le travail de deuil, essentiel pour se reconstruire après le départ d’un être cher, fut long. L’écriture en fit partie.
Le disparu laisse un vide immense. J’en compare souvent les dégâts à une ville bombardée. Il faut du temps, de la patience pour rebâtir ce qui fut anéanti. Tout est à nettoyer, dans du sang et des larmes. Les antidépresseurs ne feront que déplacer le symptôme. Il importe d’affronter la perte, d’en accepter l’irrémédiable ; seule cette temporalité permettra la suture de la plaie. La période du deuil et le travail intérieur qui s’ensuit sont l’étape nécessaire pour se réanimer, se reconnecter à ses propres désirs et reprendre le fil de sa vie.
Dans la religion juive, il est demandé aux affligés de se retirer du monde une semaine durant pour ne pas se divertir du chagrin ressenti. Cette confrontation au vide laissé par la séparation est également pour le survivant la possibilité de se redécouvrir et de s’individuer. La mort, étape vers une nouvelle croissance…
L’âme du défunt, suivant de nombreuses traditions spirituelles, poursuit son voyage, délestée de son corps physique. Puisse l’endeuillé continuer sa vie, porteur de cette promesse, la mort serait un passage dans une autre pièce.
Écrire fut une sorte d’au revoir à l’absent.
A lire
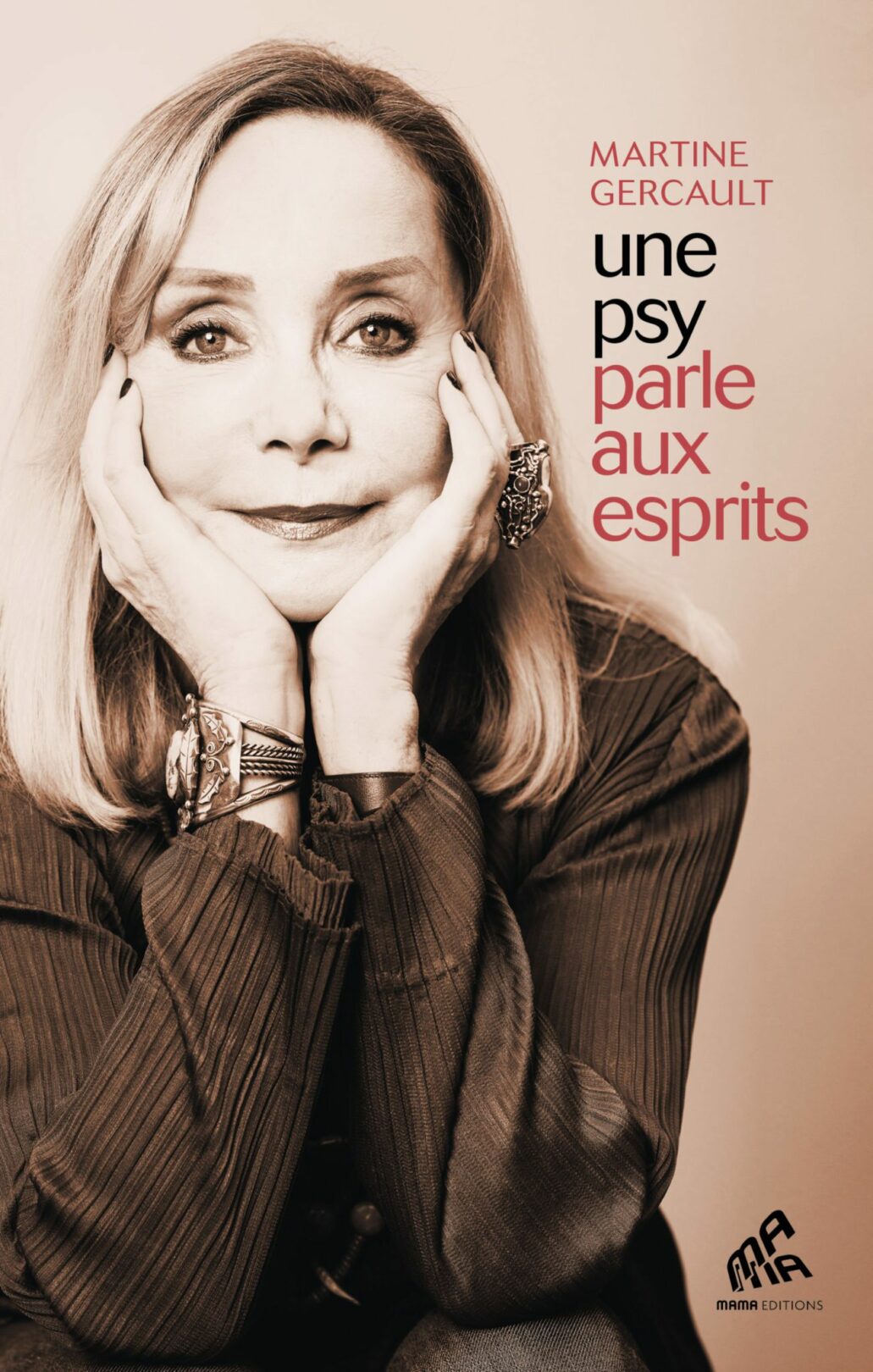 *Une psy parle aux esprits, Martine Gercault – Mama Éditions
*Une psy parle aux esprits, Martine Gercault – Mama Éditions
Un livre rempli d’espoir sur la reconstruction