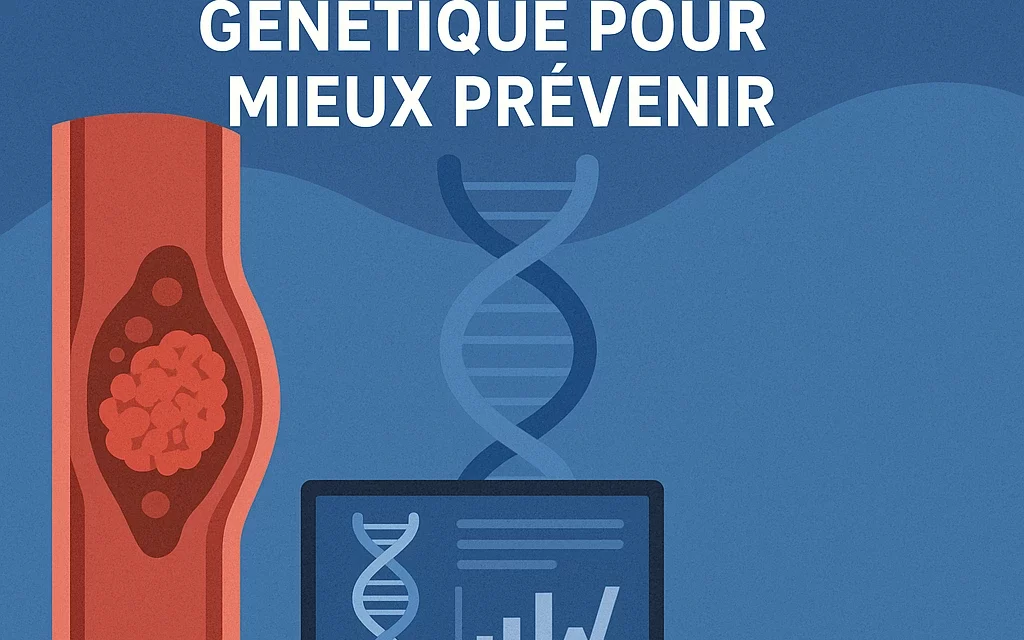Comment prédire la récidive de maladie thromboembolique veineuse ? Une étude Inserm révèle 28 marqueurs génétiques pour mieux cibler les traitements.
Comment prédire la récidive de maladie thromboembolique veineuse ? Des chercheurs Inserm ont identifié 28 marqueurs génétiques clés. Ce travail inédit pourrait transformer la prévention des rechutes en adaptant les traitements à chaque profil génétique. Une avancée décisive vers une médecine personnalisée, plus sûre et ciblée.
Prédire la récidive de maladie thromboembolique veineuse : un enjeu vital
Troisième cause de mortalité cardiovasculaire, la maladie thromboembolique veineuse (MTV) touche chaque année des dizaines de milliers de Français. Elle se manifeste par la formation d’un caillot sanguin dans une veine, risquant de bloquer la circulation et de provoquer une embolie pulmonaire. Cette affection commune, avec 1 à 2 cas pour 1 000 habitants, est aussi redoutable par son taux de récidive : 1 patient sur 5 subit un second épisode dans les cinq ans suivant le premier.
Le saviez-vous ?
La maladie thromboembolique veineuse regroupe deux pathologies principales :
-
la phlébite, aussi appelée thrombose veineuse profonde,
-
l’embolie pulmonaire, qui survient lorsque le caillot migre vers les poumons.
Elle constitue la troisième cause de mortalité cardiovasculaire en France.
Les traitements actuels reposent sur des anticoagulants qui empêchent la formation ou l’extension des caillots. Mais ces médicaments, s’ils sauvent des vies, exposent à un risque hémorragique. Dès lors, pouvoir estimer avec précision le risque de récidive permettrait d’adapter finement la durée et l’intensité du traitement pour chaque patient.
Le saviez-vous ?
Les anticoagulants sont des médicaments qui fluidifient le sang pour empêcher la formation ou l’extension des caillots.
Ils ne dissolvent pas le caillot déjà présent, mais réduisent fortement le risque de nouvelles thromboses ou d’embolies pulmonaires.
Cependant, leur usage comporte un risque d’hémorragie, ce qui rend essentiel un suivi médical adapté à chaque patient.
C’est précisément ce qu’a réussi l’équipe de David-Alexandre Trégouët, directeur de recherche à l’Inserm. En analysant les données génétiques de plus de 6 300 patients européens, les chercheurs ont mis au jour des signatures moléculaires spécifiques à la récidive, et différentes de celles du premier épisode thromboembolique.
22 de ces 28 marqueurs sont totalement inédits : jamais encore associés à la maladie.
Le saviez-vous ?
Les marqueurs génétiques sont de petites variations dans notre ADN qui peuvent influencer notre risque de développer certaines maladies ou de les voir récidiver.
Dans la maladie thromboembolique veineuse, 28 marqueurs ont été identifiés : ils permettent d’estimer le risque de récidive et d’adapter les traitements pour chaque patient.
Une approche génétique pour prédire la récidive de maladie thromboembolique veineuse
Les chercheurs se sont appuyés sur une méthodologie d’association pangénomique (une approche qui consiste à analyser l’ensemble du génome de milliers de patients pour identifier des variations génétiques liées à un risque de maladie), scrutant l’ADN, l’ARN et les protéines en jeu dans le processus de coagulation. Ils ont ensuite croisé ces données avec plusieurs critères :
- Le sexe du patient
- Le type d’événement initial : phlébite ou embolie pulmonaire
- La présence d’un facteur déclenchant (immobilisation, pilule contraceptive, etc.)
Ce travail a permis d’isoler des profils génétiques très différenciés. Les femmes et les hommes, par exemple, ne partagent pas les mêmes marqueurs de récidive. De même, les biomarqueurs varient selon que l’épisode initial ait été provoqué ou spontané.
Vers une médecine personnalisée pour la récidive de maladie thromboembolique veineuse
Cette avancée scientifique s’inscrit dans le cadre du projet européen Morpheus, qui vise à créer un outil de prédiction clinique utilisable par les médecins. Objectif : permettre une prise en charge adaptée, sûre et durable, pour limiter les risques de rechute tout en évitant des traitements trop lourds.
En France, le projet associe l’Inserm, le CHU de Brest et le réseau F-Crin Innovte. Il implique 8 pays européens et bénéficie d’un soutien du programme Horizon Europe.
« Mieux comprendre les récidives, c’est à terme offrir à chaque patient un parcours de soins personnalisé, plus sûr, plus efficace, et plus humain », souligne David-Alexandre Trégouët.
Ce qu’il faut retenir
- La maladie thromboembolique veineuse touche chaque année 50 000 à 100 000 personnes en France.
- Le risque de récidive après un premier épisode est élevé (20 % en 5 ans).
- Une équipe Inserm a identifié 28 marqueurs génétiques et protéiques associés au risque de récidive.
- Ces découvertes ouvrent la voie à des stratégies thérapeutiques personnalisées.
- Le projet Morpheus vise à développer un outil d’aide à la décision pour les cliniciens.
Ce que vous devez savoir sur la récidive thromboembolique
Qu’est-ce que la maladie thromboembolique veineuse ?
Il s’agit d’une obstruction d’une veine par un caillot sanguin. Les deux principales formes sont la phlébite et l’embolie pulmonaire.
Ces maladies thromboemboliques veineuses sont-elles génétiques ?
La plupart des cas sont liés à des facteurs acquis (immobilisation prolongée, chirurgie, contraception, etc.), mais certaines formes peuvent avoir une composante génétique. On estime qu’environ 20 à 30 % des personnes touchées présentent une prédisposition familiale ou héréditaire.
Quel est le pourcentage de récidive après un premier épisode ?
En moyenne, 20 % des patients présentent une récidive dans les cinq années suivant un premier épisode de maladie thromboembolique veineuse, même sous traitement préventif.
Pourquoi est-il important de prédire le risque de récidive ?
Pour ajuster les traitements anticoagulants et réduire le risque d’effets secondaires graves.
Les marqueurs génétiques permettent-ils de soigner ?
Pas directement mais ils permettent d’anticiper le risque et de personnaliser le suivi médical.
Quand cet outil de prédiction sera-t-il disponible ?
Il est en cours de développement dans le cadre du projet Morpheus. Des premières applications cliniques pourraient voir le jour dans les prochaines années.
Sophie Madoun