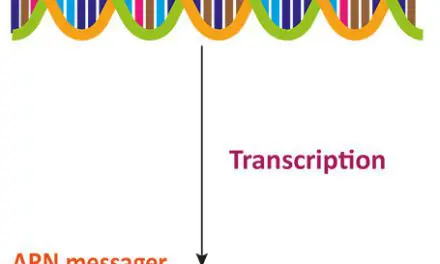Découvrez les dernières avancées dans la compréhension de la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD), une forme d’infarctus qui affecte principalement les femmes. Une nouvelle étude internationale a révélé des facteurs génétiques et des mécanismes biologiques clés liés à cette maladie, ouvrant ainsi la voie à une meilleure prise en charge et prévention.
Une nouvelle étude internationale dirigée par Nabila Bouatia-Naji, directrice de recherche à l’Inserm au Paris Centre de recherche cardiovasculaire – PARCC (Inserm/Université Paris Cité) vient de faire une avancée majeure dans la recherche sur l’infarctus touchant principalement les femmes : la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD). Souvent sous-diagnostiquée et mal comprise, cette forme d’infarctus touche neuf femmes sur dix dans la quarantaine, apparemment en bonne santé. Cependant, une nouvelle étude internationale, dirigée par Nabila Bouatia-Naji et son équipe à l’Inserm au Paris Centre de recherche cardiovasculaire – PARCC, a jeté une lumière nouvelle sur cette maladie complexe.
Qu’est ce que la dissection spontanée de l’artère coronaire ?
La dissection spontanée de l’artère coronaire : une forme d’infarctus qui touche majoritairement les femmes
La dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD) est une affection cardiaque rare mais potentiellement grave. Elle se caractérise par une déchirure ou une séparation des couches de la paroi de l’une des artères coronaires, les vaisseaux sanguins qui fournissent le muscle cardiaque en oxygène et en nutriments. Cette déchirure peut provoquer un blocage partiel ou total de l’artère, entraînant une diminution de l’apport sanguin au muscle cardiaque et pouvant provoquer un infarctus.
Un infarctus qui touche les femmes jeunes
La SCAD se différencie des autres types d’infarctus, tels que l’infarctus du myocarde causé par l’athérosclérose, car elle survient souvent chez des personnes jeunes, en particulier les femmes, qui n’ont pas de facteurs de risque cardiovasculaires évidents. Elle peut se produire de manière spontanée, sans qu’il y ait eu de traumatisme ou d’effort physique intense préalable.
Les symptômes de la SCAD peuvent varier d’une douleur thoracique intense ressemblant à une crise cardiaque classique à une douleur moins prononcée ou à une absence de symptômes. La gravité de la SCAD dépend de la taille de l’artère coronaire touchée et de l’étendue de l’obstruction.
La compréhension de la SCAD est encore limitée, mais des recherches récentes ont mis en évidence des facteurs génétiques et des mécanismes biologiques associés à cette condition.
Au cours des deux dernières décennies, d’énormes progrès ont été réalisés dans la compréhension des mécanismes sous-jacents aux maladies coronariennes, notamment l’athérosclérose, ainsi que dans l’étude de formes rares et syndromiques de maladies cardiovasculaires. Ces avancées ont joué un rôle crucial pour mieux appréhender ces affections et élaborer des stratégies de prévention et de traitement améliorées et personnalisées.
Cependant, il est important de reconnaître que la recherche a accusé un retard significatif dans la compréhension de maladies spécifiques telles que la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD), qui affecte principalement les femmes à des étapes clés de leur vie. Il est donc impératif de porter désormais une attention particulière à cette maladie cardiovasculaire peu étudiée et à son risque génétique associé.
En comprenant mieux les mécanismes biologiques et les facteurs génétiques qui contribuent à la SCAD, nous pourrons non seulement améliorer la prise en charge des patients, mais également concevoir des stratégies de prévention adaptées à cette condition spécifique. Il est donc temps de combler cette lacune de connaissances et de mettre l’accent sur la recherche visant à mieux comprendre et à traiter la SCAD, dans le but ultime de protéger la santé cardiovasculaire des femmes.
Ces avancées permettent d’améliorer le diagnostic, la prise en charge et la prévention de la SCAD, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la santé cardiovasculaire des femmes.
Avancées dans la recherche sur la SCAD
La généticienne de l’Inserm, Nabila Bouatia-Naji, a dirigé une vaste étude visant à approfondir notre compréhension de la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD). Son équipe a coordonné une méta-analyse de 8 études d’association pangénomique (GWAS), comparant les données génétiques de plus de 1900 patients atteints de SCAD et d’environ 9300 personnes en bonne santé. Les résultats ont révélé l’identification de 16 régions génomiques associées à une prédisposition génétique à la SCAD.
L’une des découvertes majeures de cette étude concerne les variations génétiques fréquemment observées chez les survivants de la SCAD, qui jouent un rôle dans la composition du « ciment » entourant les cellules de l’artère coronaire. Parmi les gènes identifiés, le gène F3 qui code le facteur de coagulation tissulaire a attiré l’attention. Des observations suggèrent que l’expression réduite de F3 chez les patients peut entraîner une mauvaise réparation des artères, pouvant conduire à leur déchirure. Ce défaut dans la résorption de l’hématome constituerait donc une cause génétique de l’infarctus, jusque-là méconnue.
Maladie cardiovasculaire féminine
Cette étude avait également pour objectif de situer la SCAD par rapport à d’autres maladies cardiovasculaires, afin de mieux comprendre ses caractéristiques épidémiologiques. Grâce à l’utilisation de données génétiques liées aux facteurs de risque cardiovasculaires et à des méthodes statistiques avancées, les chercheurs ont établi un lien solide entre une pression artérielle élevée et le risque de SCAD, tout en confirmant que des taux élevés de cholestérol, le surpoids et le diabète de type 2 n’avaient aucun impact significatif sur ce risque. Ces résultats mettent en évidence les particularités spécifiques de la SCAD par rapport à d’autres affections cardiovasculaires.
« Ce résultat pourrait donc s’avérer intéressant sur le plan clinique à plus long terme, pour encourager les médecins à surveiller de près l’évolution de la pression artérielle chez les patients et patientes qui présentent un risque génétique accru de SCAD», explique Nabila Bouatia-Naji, directrice de recherche à l’Inserm et dernière auteure de l’étude.
Une avancée majeure dans la recherche génétique de la SCAD : 16 régions génomiques identifiées
Cette étude révèle une connexion génétique entre l’infarctus dû à la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD) et l’infarctus dû à l’athérosclérose, également connu sous le nom d’infarctus athéromateux. Les chercheurs ont en effet démontré que de nombreuses régions génomiques prédisposant à la SCAD sont partagées avec celles de l’infarctus athéromateux.
Cependant, malgré le fait qu’il s’agisse des mêmes variations génétiques, les allèles qui sont plus fréquents chez les patients atteints de SCAD sont systématiquement décrits comme moins fréquents chez les sujets atteints d’infarctus athéromateux. Cette observation suggère des différences génétiques spécifiques entre les deux types d’infarctus, ce qui renforce l’idée que la SCAD a des caractéristiques distinctes nécessitant une attention et une étude spécifiques.
Ces découvertes sont essentielles pour approfondir la compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents à ces deux types d’infarctus et pour guider le développement de stratégies de prévention et de traitement adaptées à chaque condition. En comprenant mieux les similitudes et les différences génétiques, les scientifiques pourront améliorer les approches cliniques et personnalisées pour ces maladies cardiovasculaires graves.
« Ce résultat est très surprenant, car ils montrent que selon si l’on est face à une jeune femme sans facteurs de risques, ou un homme plus âgé et présentant des facteurs de risque, les causes génétiques et les mécanismes biologiques associés à leur infarctus peuvent être opposés. Nos résultats alertent sur le besoin de mieux comprendre les spécificités des maladies cardiovasculaires chez les femmes jeunes afin d’améliorer leur suivi qui est actuellement identique à celui de l’infarctus athéromateux», conclut Nabila Bouatia-Naji.
Grâce à ces résultats prometteurs, l’équipe de recherche se concentre désormais sur le développement de nouveaux modèles cellulaires et animaux qui permettront de mieux comprendre les facteurs génétiques impliqués dans la maladie. Ces modèles améliorés aideront notamment à étudier l’impact de ces facteurs sur l’état des artères, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche.
L’objectif à plus long terme de cette équipe est de mettre en lumière une maladie cardiovasculaire qui touche principalement les femmes et qui est souvent négligée. Ils s’efforcent d’améliorer la compréhension et la prise en charge de cette maladie, en lui accordant l’attention qu’elle mérite. Grâce à des avancées continues dans la recherche, ils aspirent à changer la donne et à améliorer considérablement la manière dont cette affection est diagnostiquée, traitée et prévenue.
En mettant en place des modèles de recherche plus complets et en approfondissant notre compréhension des mécanismes génétiques de cette maladie, cette équipe souhaite faire progresser les connaissances scientifiques et médicales dans le domaine des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Ce travail a le potentiel d’ouvrir la voie à des innovations et à des avancées significatives, visant à améliorer la santé cardiovasculaire des femmes et à réduire l’impact de cette maladie encore méconnue.
[1] Étude d’association génétique à grande échelle (Genome-Wide Association Studies), largement pratiquées depuis plusieurs années, qui consiste à analyser le génome entier de milliers de personnes saines et malades, afin d’identifier les régions génomiques dans lesquelles doivent se trouver des gènes influençant la vulnérabilité des personnes à l’affection en cause
[2] Un allèle est une version d’une variante génétique résultant d’un changement dans la séquence de l’ADN. Toute séquence d’ADN peut avoir plusieurs allèles, qui déterminent souvent l’apparition de caractères héréditaires différents.