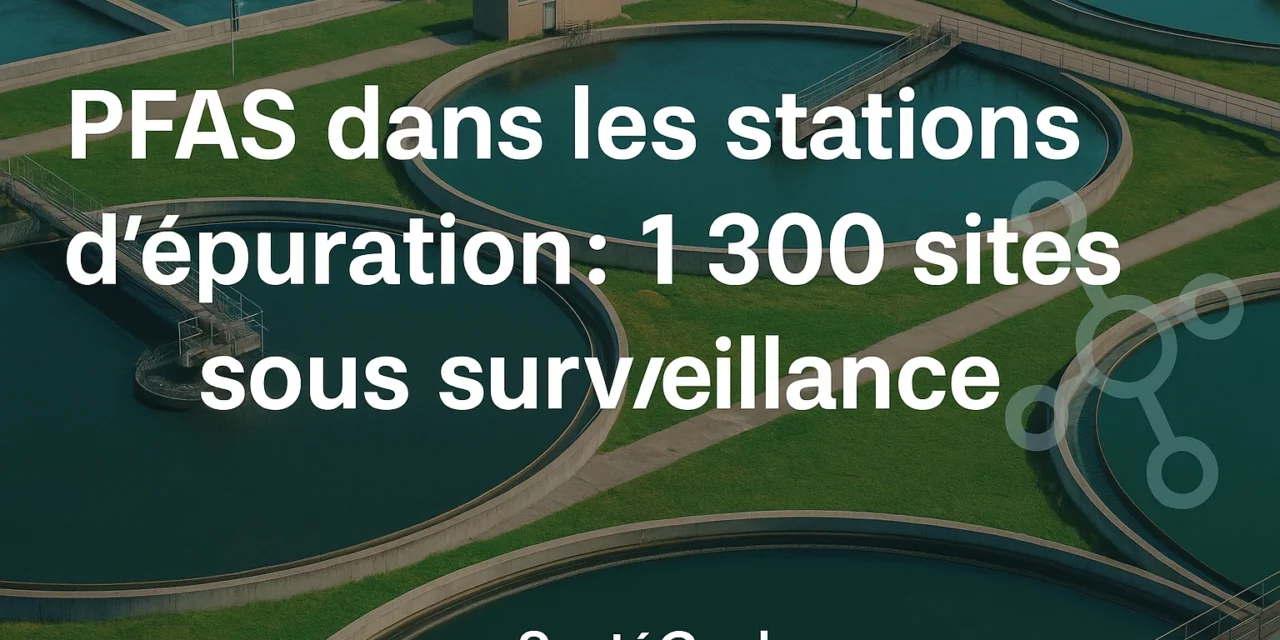PFAS dans les stations d’épuration : à la suite du rapport du Dr Cyrille Isaac-Sibille, 1 300 sites devront analyser ces “polluants éternels” pour protéger l’eau, la santé et l’environnement d’ici 2026.
Les PFAS dans les stations d’épuration sont désormais dans le viseur des autorités. Grâce au rapport du Dr Cyrille Isaac-Sibille, un arrêté du 3 septembre 2025 impose à 1 300 stations de traitement des eaux usées de surveiller ces “polluants éternels”, afin de mieux protéger la santé publique et l’environnement tout en identifiant les sources de pollution.
PFAS dans les stations d’épuration : une mesure issue du rapport du Dr Cyrille Isaac-Sibille
Cette avancée majeure découle directement d’une proposition du rapport gouvernemental du Dr Cyrille Isaac-Sibille, reprise dans le plan d’action interministériel sur les PFAS lancé en avril 2024.
Selon le Dr Isaac-Sibille, « à la suite de ma saisine du Gouvernement et à mon rapport gouvernemental, lancement d’un contrôle des rejets des stations de traitement des eaux usées urbaines ».
Cette campagne permettra aussi de mieux surveiller la qualité de l’eau, la production d’eau potable, de limiter les contaminations par des résidus ou pesticides, et de protéger les ressources en eau face aux rejets industriels. Les données collectées de capatge contribueront à préserver les milieux aquatiques et à renforcer la sécurité des cours d’eau qui alimentent la distribution d’eau dans les communes.
1 300 stations d’épuration concernées par le contrôle des PFAS
Les stations visées sont celles de plus de 10 000 équivalents-habitants, soit environ 1 300 sites répartis sur tout le territoire. Elles devront participer à une campagne nationale de surveillance afin d’améliorer la connaissance des sources d’émission de ces substances chimiques persistantes.
Les contrôles s’étendront à des paramètres liés au traitement de l’eau et à l’assainissement, avec une attention particulière aux eaux pluviales et aux eaux souterraines qui peuvent être contaminées via les canalisations ou les bassins de rétention. Les autorités souhaitent aussi mieux comprendre la présence éventuelle de micro-organismes et de pathogènes dans les eaux brutes avant leur filtration et désinfection.
22 substances ciblées dans les stations d’épuration
D’ici le 31 décembre 2026, 22 substances devront être analysées :
20 PFAS visés par la directive européenne sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2 PFAS provenant des mousses anti-incendie.
Selon le Dr Isaac-Sibille, « la campagne de surveillance sera étendue à d’autres substances PFAS lorsque celles-ci auront été quantifiées dans les rejets aqueux des ICPE raccordées au réseau public d’assainissement ».
Méthodologie de contrôle des PFAS dans les stations d’épuration
Chaque station devra réaliser trois prélèvements et analyses espacés d’un mois, en entrée et en sortie de traitement.
Les limites de quantification sont fixées à 50 ng/L en entrée, 20 ng/L en sortie et 2 µg/L pour la méthode AOF (adsorption du fluor organique).
Comme l’indique le député, « ces analyses permettront de connaître les concentrations de PFAS, mais aussi d’estimer la quantité totale de PFAS présents dans les eaux en sortie de station ».
Pourquoi les PFAS dans les stations d’épuration représentent un enjeu sanitaire
Utilisés depuis des décennies pour leurs propriétés antiadhésives, hydrofuges et résistantes à la chaleur, les PFAS se retrouvent dans des ustensiles de cuisine, des textiles, des emballages ou encore des mousses anti-incendie.
Ils ne se dégradent pas, s’accumulent dans l’environnement et dans l’organisme humain, et sont associés à des risques de cancers, de perturbations hormonales et d’atteintes au système immunitaire.
Selon le Dr Isaac-Sibille, « c’est un pas de plus pour la protection de notre santé et de notre environnement ».
Transparence et accès public aux résultats
Le Dr Isaac-Sibille insiste sur la diffusion des données : « Je reste vigilant pour que ces résultats soient rendus publics, disponibles et accessibles à tous les acteurs : collectivités, élus, habitants ».
Les gestes simples pour limiter son exposition aux PFAS
96 % de l’eau du robinet contaminée par des polluants éternels
Pour les citoyens, il est possible d’agir en :
S’informant sur la qualité de l’eau du robinet distribuée localement.
Réduisant l’usage de produits contenant des PFAS.
Soutenant les initiatives associatives engagées dans la surveillance environnementale.
Qualité de l’eau : réponses expertes pour mieux comprendre
Quelle est la différence entre la qualité de l’eau et la qualité de l’eau potable ?
La qualité de l’eau désigne l’ensemble des paramètres physico-chimiques, microbiologiques et organiques qui permettent d’évaluer si une eau peut être consommée. La qualité de l’eau potable se réfère à une eau traitée et respectant les limites de qualité fixées par le Code de la santé publique pour être destinée à la consommation humaine.
Qu’est-ce qu’un contrôle sanitaire de l’eau ?
Le contrôle sanitaire est assuré par l’Agence régionale de santé (ARS). Il comprend des analyses physico-chimiques, la recherche de micropolluants, de germes et de substances organiques, afin de garantir la conformité aux références de qualité et la sécurité de l’eau distribuée.
Comment l’eau est-elle captée et traitée avant distribution ?
L’eau peut provenir de nappes souterraines, d’eaux de surface comme les rivières, ou de sources superficielles. Après le captage, elle est envoyée vers une station de traitement où elle subit la filtration, la désinfection (souvent au chlore) et le stockage dans des réservoirs avant la distribution d’eau potable.
Quels sont les risques de contamination de l’eau ?
Les risques incluent la présence de PFAS, de micropolluants, de pesticides, de plomb, de germes pathogènes ou de matières organiques. La contamination peut se produire dans le milieu naturel, au moment du captage, ou dans le réseau d’eau si les infrastructures vieillissent.
Comment assurer la qualité de l’eau distribuée ?
La qualité de l’eau distribuée repose sur un suivi régulier : analyses en sortie de station de traitement, contrôle des réservoirs, entretien du réseau de distribution, et application stricte des normes de potabilisation. Les résultats sont communiqués par l’Agence régionale de santé (ARS) et affichés en mairie.
Que signifient “eaux brutes” et “eaux traitées” ?
Les eaux brutes sont les eaux prélevées directement dans la nature (nappes, rivières, eaux superficielles) avant tout traitement. Les eaux traitées ont subi un traitement de l’eau dans une station de traitement pour devenir de l’eau potable conforme aux références de qualité.
Sophie Madoun