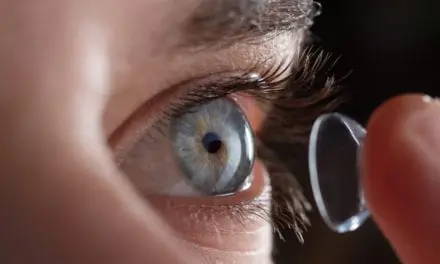Les seniors en France peuvent choisir de vivre soit à leur domicile, soit en établissement. Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients pour les seniors. À l’heure où le « virage domiciliaire » constitue une orientation majeure des politiques publiques du grand âge, la DREES met en lumière les questions posées par la volonté de « désinstitutionnalisation » des personnes âgées. Alors, quelles sont les différences entre les séniors vivant à domicile et ceux en établissement ?
Les seniors qui choisissent de vivre à leur domicile peuvent jouir de plus d’indépendance et de liberté. Ils peuvent continuer à vivre selon leurs propres règles et à entretenir leur propre vie sociale et familiale. Cependant, vivre à la maison peut parfois devenir difficile pour les seniors, surtout s’ils ont des besoins de soins médicaux spéciaux. Mais quelles sont les différences entre les séniors vivant à domicile et ceux en établissement ?
Différences entre les séniors vivant à domicile et ceux en établissement
Les seniors qui choisissent de vivre en établissement bénéficient souvent d’un environnement sécurisé et d’une assistance 24h/24. Les établissements de soins pour seniors offrent également des activités récréatives et des services de restauration pour aider les seniors à maintenir un mode de vie actif. Cependant, vivre en établissement peut signifier renoncer à une certaine liberté et indépendance, et certains seniors peuvent se sentir isolés.
Il est important de prendre en compte les besoins et les souhaits de chaque senior lorsqu’ils décident s’ils préfèrent vivre à domicile ou en établissement. Les seniors et leur famille devraient évaluer les options disponibles, y compris le coût, la qualité des soins et la proximité géographique des établissements, pour déterminer la meilleure solution pour leur situation.
En fin de compte, qu’ils choisissent de vivre à domicile ou en établissement, les seniors méritent un environnement sûr, confortable et stimulant qui répond à leurs besoins uniques. Les familles et les professionnels de la santé peuvent travailler ensemble pour aider les seniors à faire le choix le plus approprié pour leur situation et garantir une vie de qualité à la fin de leur vie.
Les enquêtes Capacités, aides et ressources des seniors (Care) ont été menées par la DREES en 2015 et 2016 auprès de personnes de 60 ans ou plus résidant en France métropolitaine, à domicile ou en établissement pour personnes âgées. ), Elles ont la particularité d’interroger de façon comparable les personnes quel que soit leur lieu de vie.
Les résidents d’établissement les plus jeunes sont plus isolés et socialement défavorisés
Parmi l’ensemble des seniors de 75 ans ou plus, près d’un sur dix vit en établissement d’hébergement. Les résidents d’établissement ont 86 ans en moyenne, et les trois quarts sont des femmes. Un senior sur quatre en établissement n’a aucun enfant en vie, contre un sur dix à domicile, et un sur trois n’a aucun petit-enfant, contre un sur cinq à domicile. On retrouve donc des résultats connus (Abdoul-Carime, 2021) : les personnes en établissement, surtout les plus jeunes, sont plus isolées sur le plan familial que les personnes à domicile.
Elles sont également socialement plus défavorisées. Les différences sont beaucoup plus marquées parmi les moins de 80 ans. Les anciens ouvriers sont fortement surreprésentés en établissement parmi les hommes, et parmi les hommes de moins de 80 ans vivant en établissement, 11 % n’avaient pas de profession avant l’âge de la retraite, contre 0,2 % à domicile. Ce pourcentage très important peut indiquer qu’il s’agit de personnes ayant eu un handicap avant leur entrée en établissement, ou des difficultés d’insertion les ayant maintenus dans l’inactivité, et souligne encore une fois la plus grande vulnérabilité sociale de ces résidents les plus jeunes. Ces écarts se retrouvent dans la distribution des revenus et des niveaux de vie. En établissement, les personnes les plus jeunes ont les niveaux de vie les plus faibles, puis ceux-ci se stabilisent à partir de 75 ans, âge à partir duquel ils sont plus proches à domicile et en établissement.
En établissement, des limitations motrices et cognitives importantes à tous les âges
La fréquence des difficultés sensorielles à chaque âge n’est pas très différente selon le lieu de vie : les limitations auditives sont croissantes avec l’âge, au même rythme à domicile et en établissement, et la majorité des personnes âgées entendent sans difficulté dans une pièce silencieuse jusqu’à 90 ans, quel que soit le lieu de vie.
Les difficultés motrices importantes, à tous les âges, sont caractéristiques des personnes en établissement : à tous les âges, et dès 60 ans, une majorité des résidents ont beaucoup de difficultés à se pencher ou s’agenouiller, monter un escalier ou porter 5 kilos sur 10 mètres.Enfin, les limitations cognitives augmentent avec l’âge pour les personnes à domicile, mais les prévalences restent modérées à tous les âges. En établissement en revanche, les trous de mémoire, les difficultés pour comprendre et se faire comprendre, pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, et les difficultés à nouer des relations sont fréquentes à tous les âges.
Les personnes de moins de 75 ans en établissement ont donc des limitations particulièrement importantes pour leur âge, tandis que les résidents les plus âgés ont des limitations sensorielles et physiques proches des personnes vivant à domicile, mais bien plus de limitations cognitives. Cela explique en partie le taux particulièrement élevé de personnes sous protection juridique en établissement, supérieur aux deux tiers pour les résidents de moins de 75 ans.
Deux types de population sous un même toit
Ces résultats mettent en évidence les différences entre les personnes âgées à domicile et en établissement, à âge comparable (notamment la forte prévalence des limitations cognitives en établissement, à tous les âges), mais aussi certaines ressemblances, surtout aux grands âges, comme sur les limitations sensorielles et physiques ou les caractéristiques socio-économiques.
Ils montrent également la dualité des publics accueillis en Ehpad, en deçà et au-delà de l’âge de 75 ans environ. Cette dualité était déjà connue, mais cette étude est la première à la documenter dans toutes ses dimensions : limitations fonctionnelles, caractéristiques démographiques, diplômes, revenus, protection juridique…
Elle interroge les politiques publiques, sur l’accueil en un même lieu, et selon les mêmes modalités, de plusieurs publics aux caractéristiques si différentes.
On trouve ainsi, parmi les plus jeunes résidents d’Ehpad, des personnes handicapées vieillissantes, aux besoins d’aide assez importants, ou des personnes présentant des troubles psychiques. Les besoins de ces publics sont différents, leur prise en charge n’implique pas les mêmes tâches et pas nécessairement la même charge de travail, ce qui a des conséquences sur l’organisation des établissements et de leur personnel.
Des résultats qui interrogent les conditions d’un « virage domiciliaire »
La comparaison des caractéristiques des seniors vivant en établissement et à domicile permet enfin de préciser les conditions de possibilité concrètes d’un maintien à domicile important, voire total, des publics actuels des Ehpad. Les conditions économiques et sociales du soutien à leur autonomie doivent donc être anticipées, au regard des caractéristiques que l’on vient de décrire : le relatif isolement social et les faibles revenus des plus jeunes, le fait qu’un quart d’entre eux est sous protection juridique, la prévalence très importante des troubles cognitifs et moteurs…
Elles impliquent en particulier l’existence et la viabilité économique d’un important secteur de l’aide à domicile, entendue au sens large : aide ménagère, au repas, à la toilette, etc.mais aussi une prise en charge médicale et paramédicale à domicile, qui correspondrait aux tâches assurées aujourd’hui par le personnel sanitaire des Ehpad : celles-ci vont de l’aide à la prise de médicaments, aux nombreux actes infirmiers ou de kinésithérapie par exemple, jusqu’à la prise en charge de la fin de vie (soins palliatifs).