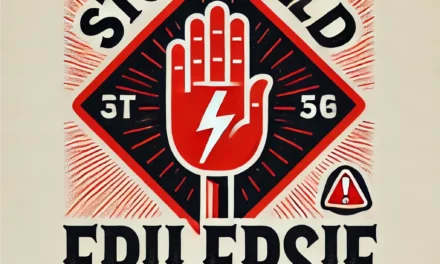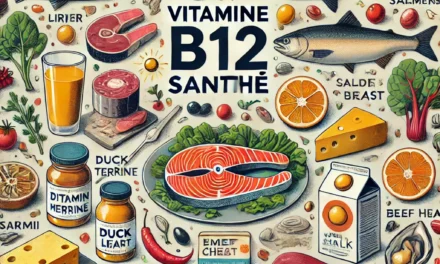Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’Alliance contre le tabac, qui réclamait un durcissement des contrôles sur la vente de tabac et de produits du vapotage aux mineurs. Voici pourquoi la plus haute juridiction estime que les mesures actuelles suffisent.
Le 1er octobre 2025, le Conseil d’État a rejeté le recours de l’Alliance contre le tabac.
L’association réclamait que l’État prenne de nouvelles mesures pour mieux faire respecter l’interdiction de la vente de tabac et de vapotage aux mineurs.
Selon la plus haute juridiction administrative, les actions déjà engagées suffisent pour l’instant, même si le non-respect de la loi reste préoccupant.
Mineurs et vapotage : le Conseil d’État refuse d’aller plus loin
Le recours de l’Alliance contre le tabac
Face à la hausse du vapotage chez les jeunes, l’Alliance contre le tabac (ACT) avait saisi le Conseil d’État pour obliger le gouvernement à renforcer les contrôles et les sanctions.
L’association pointait du doigt un constat alarmant : de nombreux mineurs parviennent encore à se procurer des produits du tabac ou des cigarettes électroniques, malgré l’interdiction formelle inscrite dans la loi.
ACT demandait notamment :
des contrôles plus fréquents dans les bureaux de tabac ;
des sanctions plus sévères pour les buralistes en infraction ;
une transparence accrue sur les résultats des contrôles.
Ce que dit la loi française
En France, la vente et l’offre gratuite de tabac et de produits du vapotage sont interdites aux moins de 18 ans.
Les articles L.3512-12 et L.3513-5 du code de la santé publique rappellent que les débitants peuvent demander une pièce d’identité à leurs clients pour vérifier leur âge.
Depuis juin 2025, les sanctions ont été durcies : les contrevenants risquent désormais une amende de cinquième classe (jusqu’à 1 500 euros), des poursuites disciplinaires et la suspension de leur licence.
En dépit de cette interdiction claire, la vente de tabac aux mineurs reste une réalité préoccupante sur l’ensemble du territoire français.
Pourquoi le Conseil d’État a rejeté la requête ?
Dans sa décision du 1er octobre 2025 (n°498453), le Conseil d’État reconnaît que l’interdiction de vente aux mineurs est insuffisamment respectée, notamment chez les buralistes.
Mais il estime que l’État n’a pas failli à ses obligations, car plusieurs actions concrètes ont déjà été engagées.
Parmi elles :
la formation obligatoire des buralistes, désormais centrée sur la prévention du tabagisme chez les jeunes ;
la hausse des amendes et le durcissement des sanctions ;
la mise en place d’un protocole interministériel pour renforcer les contrôles ;
et la stratégie nationale de lutte contre les conduites addictives 2023-2027, qui comprend un plan d’action dédié au tabac et au vapotage.
Le juge souligne aussi la difficulté particulière des contrôles, puisqu’une infraction ne peut être constatée qu’en flagrant délit.
Conclusion : pas d’inaction de l’administration, donc pas de raison d’imposer de nouvelles mesures.
Tabac et e-cigarette : quand la loi peine à protéger les mineurs
Même si le Conseil d’État n’a pas ordonné de nouvelles actions, sa décision relance le débat sur la protection des jeunes face au tabac et au vapotage.
Les données de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) restent préoccupantes :
près de la moitié des élèves fumeurs de troisième disent avoir déjà acheté un paquet de cigarettes, et les produits de vapotage séduisent toujours plus d’adolescents.
Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables à arômes fruités, ont d’ailleurs été interdites en France depuis février 2025, en raison de leur impact environnemental et de leur attrait massif chez les mineurs.
Le vapotage n’est pas sans risque : même sans tabac, les e-cigarettes contiennent souvent de la nicotine, responsable d’une forte dépendance.
De plus, les saveurs sucrées et la publicité sur les réseaux sociaux banalisent leur usage, rendant la prévention plus complexe.
Les mesures déjà en place
Pour tenter d’enrayer ce phénomène, les pouvoirs publics ont lancé plusieurs programmes :
le plan national de lutte contre le tabac 2023-2027, qui mise sur la formation et la responsabilisation des buralistes ;
la conditionnalité des aides financières au respect de la loi ;
la coopération entre les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de l’Économie pour les contrôles ;
et la campagne de sensibilisation auprès des jeunes sur les dangers de la nicotine.
Ces dispositifs visent à réduire drastiquement l’accès des mineurs aux produits du tabac et du vapotage, tout en maintenant la pression sur les distributeurs.
Tabac et e-cigarette : quand la prévention des mineurs reste la clé
La décision du Conseil d’État n’affaiblit pas la politique de santé publique : elle rappelle au contraire que l’interdiction doit s’accompagner d’éducation et de prévention.
Car interdire ne suffit pas : il faut sensibiliser les jeunes, impliquer les familles et mobiliser les établissements scolaires.
Le défi, désormais, est de transformer les interdictions légales en réflexes collectifs — pour que les nouvelles générations ne deviennent plus dépendantes avant même la majorité.
Le débat sur la vente de tabac et de vapotage aux mineurs ne faiblit donc pas, tant le sujet touche à la santé, à la responsabilité des commerçants et à la protection de la jeunesse.
La réussite du plan national 2023-2027 dira si ces efforts suffisent… ou s’il faudra, à terme, un nouveau tour de vis.
Questions clés sur le tabac, le vapotage et les mineurs
Les puffs sont-elles encore autorisées en France ?
Non. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, sont interdites à la vente depuis février 2025, quel que soit l’âge de l’acheteur.
Que risquent les buralistes qui vendent à des mineurs ?
Ils encourent une amende de cinquième classe, des poursuites disciplinaires et la suspension de leur licence.
L’interdiction de vente de tabac et de vapotage aux mineurs est-elle récente ?
Non. Elle remonte à la loi du 31 juillet 2003, renforcée en 2010, puis élargie aux produits du vapotage avec le décret de 2016.
Pourquoi le Conseil d’État a-t-il refusé d’aller plus loin ?
Parce qu’il considère que l’État agit déjà activement : formations, contrôles, sanctions et stratégie nationale jusqu’en 2027.
Sophie Madoun